La notion de système de notation est traditionnellement associée à la transformation d'une seule performance en une note (système uni-critère). Or, de nombreux objectifs pédagogiques manipulent deux indices, voire plus. Par exemple, si l'objectif d'un cycle de course de durée porte sur la régularité d'allure, il sera souhaitable que l'évaluation sommative tienne compte de ce facteur aussi bien que de la performance finale (soit la distance parcourue). Autre exemple, nous pourrions envisager, en natation sportive, l'emploi d'un système de notes prenant en compte un indice pédagogique (le nombre de cycles de bras par exemple et un indice morphologique, la taille des bras) capable de relativiser l'indice pédagogique.
Nous nommerons SYSTEME D'EVALUATION MULTI-CRITERES un système permettant de gérer plusieurs indices pédagogiques. Ce type d'évaluation est indispensable dès lors que nous pouvons repérer des indices multiples dont l'interaction explique l'évolution d'une performance finale.
Le premier avantage lié à l'utilisation de systèmes de notation multi-critères concerne la cohérence de l'évaluation sommative par rapport aux objectifs visés. Il paraît, en effet, souhaitable que le système de notation colle au plus près à la stratégie éducative de l'enseignant. Pour reprendre l'exemple des objectifs de course de durée évoqués dans les premières lignes, il serait aberrant qu'un travail très fin sur l'allure de course visant à augmenter la distance de course ne soit évalué, en définitive, que sous ce dernier aspect.
En effet, nous savons très bien qu'en natation, un travail sur le rythme ne se traduira pas immédiatement par une augmentation significative de la distance de course. La notation doit alors tenir compte de la progression différente des différents indices. Ce principe devient une nécessité lorsque l'on sait que, pour certaines disciplines (logique interne des APS), la recherche d'un comportement moteur donné entraîne, pour une durée plus ou moins longue, une baisse de la performance mesurée. Ce cas se vérifie souvent en natation. La recherche d'un style de nage plus en "amplitude" qu'en "fréquence" s'accompagne généralement d'une diminution ou d'une stagnation de la vitesse tant que les sensations kinesthésiques ne sont pas fixées, puis d'un gain conséquent dans un deuxième temps. Lorsqu'on sait que cet apprentissage peut se faire sur plusieurs années, on mesure très bien l'incohérence d'une notation fondée uniquement sur la performance finale.
Nous retiendrons donc que chaque indice a une logique d'évolution particulière. Les systèmes multi-critères ont donc les propriétés suivantes :
Nous noterons également que les éléments mathématiques composant un système de notation multi-critères favorisent une véritable analyse pédagogique de l'enseignant vis à vis de l'impact des notes dans sa stratégie éducative. Par exemple, en natation sportive, un objectif de transformation des conditions d'équilibre prenant en compte deux indices en interaction, un indice révélateur des capacités respiratoires (puisque l'immersion de la tête, conditionnant l'équilibre, est liée à l'inversion du système respiratoire du terrien) et un indice révélateur de la surface de résistance à l'avancement, pourra faire l'objet du raisonnement suivant :
Le but de cet objectif est de diminuer le nombre de cycles de bras révélateur de l'importance du maître couple du corps dans l'eau.
L'acquisition d'une position sur l'eau limitant au maximum la surface de résistance au déplacement passe par l'immersion de la tête et donc par une modification éventuelle du mécanisme respiratoire. Il faut donc favoriser, chez les élèves, la recherche d'un style de nage avec tête immergée. Le système de notation doit donc principalement être axé sur le nombre de cycles tout en supportant deux types de contrats :
- "payer" les élèves dont le niveau de maîtrise respiratoire initial est suffisant pour envisager un travail axé sur la propulsion.
- ne pas pénaliser les élèves, qui, ayant un niveau respiratoire insuffisant, devront travailler principalement sur des objectifs respiratoires et ne pourront pas diminuer de manière significative leur nombre de cycles de bras.
Par la manipulation des éléments du système, l'enseignant pourra déterminer un modèle spécifique à ses élèves et à sa stratégie éducative, afin de favoriser une progression rapide des notes de l'indice respiratoire, associé à une progression normale des notes du deuxième indice.
En travaillant sur la logique de progression des notes de chaque indice, l'enseignant peut donc introduire une stratégie éducative. En pondérant les notes elles-mêmes, il peut également donner un poids plus important à un indice sans modifier la logique de progression évoquée plus haut.
La nécessité d'une adaptation fine du système de notation aux conditions d'enseignement, à la spécificité de la population, à la stratégie éducative de l'enseignant impose l'emploi de modèles gérant plusieurs paramètres. Ces paramètres interagissent les uns par rapport aux autres. Résumons les :
- - Couples (p, n) déterminant deux points particuliers sur une droite de type y = ax+b.
- - exposant de la fonction y = axn + b permettant de fixer, éventuellement, la non-linéarité de la courbe de progression des notes.
- - coefficient de pondération des indices.
La complexité apparente de ces systèmes ne doit plus être un obstacle à leur exploitation. L'ordinateur doit prendre en charge l'ensemble des calculs nécessaires et favoriser, par l'emploi d'outils conviviaux, la manipulation des paramètres.
La diversité des cas ne permet pas de définir des réglages pré-programmés, tout au plus de proposer des repères. Il s'agit donc de disposer d'un outil permettant de visualiser l'impact de chaque paramètre afin de favoriser la construction d'un système répondant aux attentes de l'enseignant. C'est cette fonction de simulation que nous rattacherons principalement à l'outil informatique pour qu'il devienne réellement un outil pédagogique.
La conclusion à laquelle nous sommes parvenus en analysant les conditions de construction des systèmes de notation, qu'ils soient uni-critère ou multi-critères, est qu'il est nécessaire de disposer d'un outil favorisant une simulation par "essai-erreur".
Nous chercherons donc, dans l'informatique, les moyens :
- - de prise en charge totale des calculs nécessaires.
- - de visualisation immédiate des effets des réglages de chaque paramètre.
- - de restitution du système construit sous une forme facilitant son exploitation future.
C'est l'objet du logiciel EVALOGIC.
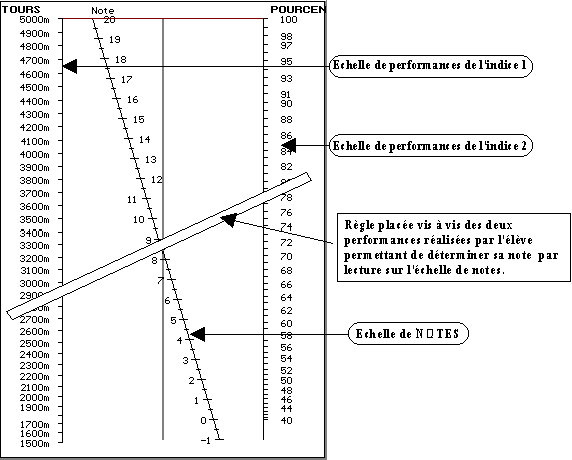
Le but d'un NOMOGRAMME est de montrer graphiquement (figure 1) la relation qui existe entre deux indices (ou deux critères) mesurables afin d'obtenir un résultat synthétisant l'impact de cette relation.
EVALOGIC, simulateur informatique de systèmes de notation multi-critères, utilise ce type de représentation pour favoriser la construction de modèles de notation par un enseignant. Il dispose d'outils permettant de construire le système puis de le restituer sous une forme exploitable par l'enseignant ou les apprenants (barèmes à deux dimensions ou nomogrammes).
Le nomogramme se construit généralement à l'aide de 3 segments de droites. Chaque segment est caractérisé par une échelle spécifique. Sur le premier segment (ou montant), on inscrira l'échelle de progression des résultats d'évaluation du premier indice en se référant à un système de notation. Sur le deuxième montant, on placera les données du deuxième indice d'évaluation en se référant à son système de notation. Le référentiel de notation est gradué sur le troisième segment placé entre les deux montants précédemment construits.
Ainsi en joignant deux performances ou résultats par un trait, on coupe la droite de notation en un point qui représente la note combinée obtenue pour les deux résultats d'évaluation. Ce "trait", coupant la droite de note, est appelé DROITE D'EVALUATION.
DETERMINATION DU SYSTEME DE NOTATION
Un système de notation correspond à la construction de DEUX FONCTIONS DE TRANSFORMATION d'une performance en note (une par indice) et d'un COEFFICIENT DE PONDÉRATION donnant éventuellement un poids plus important à un indice par rapport à l'autre.
Cette droite représente la relation linéaire qui existe entre la progression des performances et la notation associée. Cette droite est de type y = ax + b.
Dans le système EVALOGIC, elle est déterminée par l'enseignant au moyen de DEUX COUPLES (performance, note) pour lesquels une relation peut être établie par expérience. Par exemple, l'enseignant attribuera la note 10/20 à une performance jugée, par lui, moyenne, et 20/20 à une performance considérée comme maximale pour le niveau auquel il a à faire.
La notion de non-linéarité de la progression des notes est importante puisque nous savons que plus une performance de départ est élevée, plus la progression sera difficile. L'utilisation d'une courbe exponentielle ou logarithmique (suivant le sens de progression mathématique des performances par rapport à la progression des notes) permet de compenser cette difficulté de progression. Mais un enseignant pourra également choisir une progression de notes plus importante lorsque les performances sont basses pour favoriser la motivation de ces élèves. Il faut donc lui donner la responsabilité de l'allure définitive de la courbe de progression des notes.
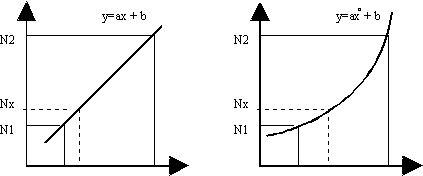
|
|
| Figure 2a | Figure 2b |
La prise en compte de la non-linéarité est donc réalisée au moyen d'une fonction y = axn + b. L'élévation à la puissance n assure la transformation d'une droite de progression des notes en une courbe de notes.
La valeur donnée à l'exposant 'n' sera donc révélatrice de la stratégie employée par l'enseignant :
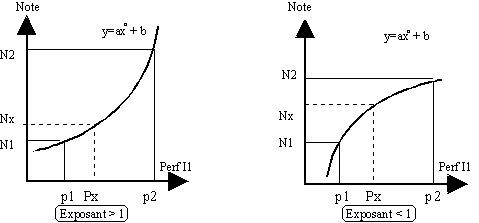
|
|
| (figure 3a) | (figure 3b) |
Pour accorder un poids plus important à l'un ou à l'autre des indices d'évaluation, il faut multiplier la note de l'indice que l'on veut pondérer par un coefficient. Avec le système de nomogramme, il suffit de rapprocher ou d'éloigner plus ou moins, la droite de notation (segment du milieu) de l'un ou l'autre des montants : plus la droite de note est éloignée d'un montant et plus le coefficient attribué à l'indice représenté par ce montant est faible.
Ainsi il nous est maintenant possible de prendre plus ou moins en compte l'un ou l'autre des deux indices d'évaluation dans l'attribution de la note finale. Nous nommerons ce coefficient de pondération le COEFFICIENT ABSOLU pour le distinguer des COEFFICIENTS DE NOTES qui permettent d'affiner l'interaction des deux indices.
c. AFFINER L'INTERACTION DES DEUX INDICES.
Un coefficient absolu a une action globale sur la notation. Cela signifie que quelque soient les notes obtenues, qu'elles soient faibles, fortes ou moyennes, la même pondération d'un indice par rapport à l'autre est appliquée. EVALOGIC peut différencier cette application en permettant de répartir la pondération de manière différente suivant que l'élève se trouve en début ou en fin de progression. Il utilise, pour cela, la notion de coefficient de pondération de notes (COEFFICIENT DE NOTES). Pour les deux notes repères (notes des couples [p1, n1; p2, n2]), l'enseignant attribue un coefficient de pondération (cp1; cp2).
Par exemple: Je désire construire un nomogramme devant prendre en compte une durée de course et une distance maximale à parcourir pour un temps donné maximal. Je peux considérer qu'un élève qui parcourt la distance maximale demandée, aura nécessairement couru pendant une durée largement suffisante.
Dans son cas il est peut-être possible d'affecter au coefficient de durée, une valeur plus faible que pour le coefficient de distance.
Mais le même nomogramme doit pouvoir être utilisé pour des élèves qui auront couru médiocrement pendant une durée faible. Il serait alors faux de maintenir pour eux, les coefficients précédemment établis.
Ce problème peut être résolu en inclinant la droite de notation (ANGULATION DE LA DROITE DE NOTES) plus ou moins vers l'un ou l'autre des montants. Ainsi les coefficients varient constamment avec les positions occupées par les performances sur chacun des deux montants.
REMARQUE : Nous pouvons observer que les coefficients de notes suivent la même logique que le coefficient absolu. En fait, les coefficients de notes ne sont que l'expression du coefficient absolu vu sous l'angle d'une FONCTION et non plus sous celui d'un INDICE particulier.
Vous devez définir ce que vous désirez évaluer, quantifier les deux indices d'évaluation et choisir les coefficients judicieusement pour que votre évaluation finale reflète le travail accompli au cours des séances passées.
Présenté à l'élève, le nomogramme lui permet de se situer et d'élaborer une stratégie de travail qui lui permettra de gagner le maximum de points en travaillant dans l'une ou l'autre des deux dimensions... voire les deux en même temps.
Il permet donc aussi à l'enseignant de représenter graphiquement ses intentions pédagogiques au travers de barèmes qui viendront concrétiser les progrès.